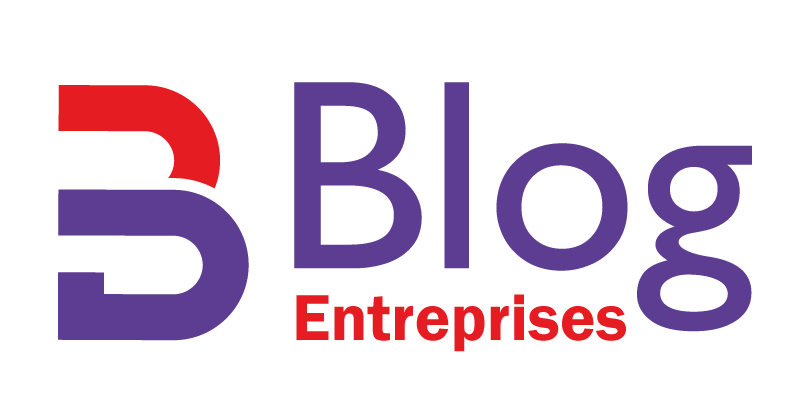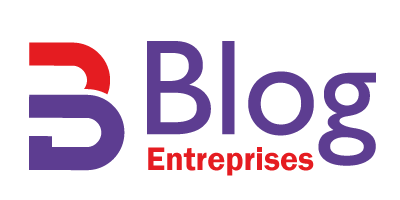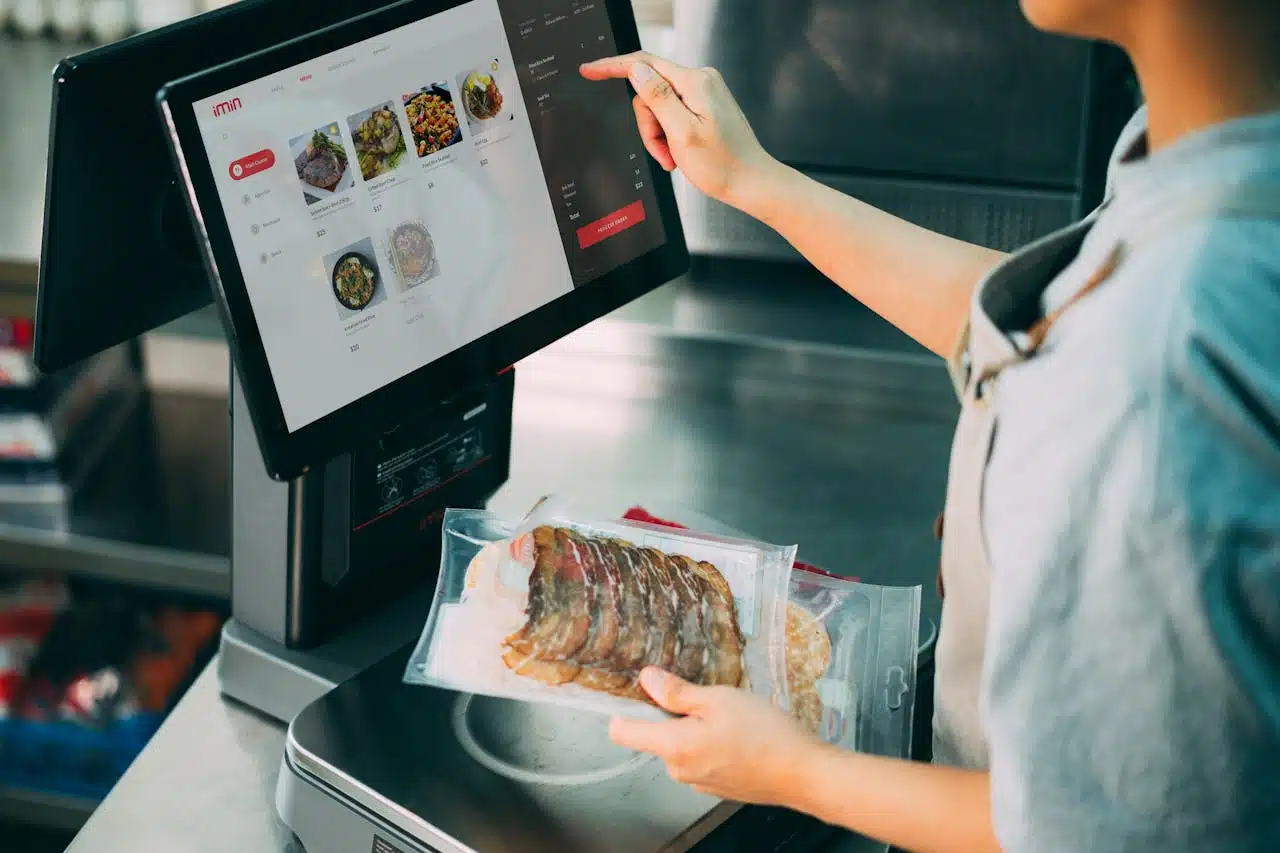Ouvrir le Code du travail, c’est tomber sur une liste longue comme le bras : vingt-cinq critères, soigneusement alignés, qui définissent la discrimination aux yeux de la loi française. Derrière ces mots, des réalités bien concrètes. Un refus d’embauche à cause d’une adresse, un licenciement motivé par un état de santé, et voilà que la machine juridique s’enclenche, même sans volonté malveillante affichée.
Cette protection va bien plus loin que la porte du bureau. Emprunter, louer un logement, accéder à un service : autant de moments où le couperet de l’inégalité peut tomber sans prévenir. Repérer une discrimination, c’est souvent débusquer l’invisible. Les lois existent, mais faire reconnaître une injustice demande de réunir des preuves précises, souvent ignorées du grand public.
Comprendre la discrimination : de quoi parle-t-on vraiment ?
La discrimination n’a rien d’une vague hostilité ou d’une maladresse verbale. Elle s’incarne dans un traitement défavorable, parfois insidieux, basé sur ce que la loi interdit de prendre en compte. D’un côté, l’article L1132-1 du Code du travail ; de l’autre, l’article 225-1 du Code pénal. Ensemble, ils fixent la règle : toute différence de traitement injustifiée tombe sous le coup de la loi. Et pas besoin d’une motivation explicite : la simple existence d’un critère interdit suffit.
Au travail, la discrimination touche toutes les étapes : embauche, évolution, salaire, rupture de contrat. L’employeur doit garantir l’égalité, protéger chaque salarié, et agir dès le moindre signal d’alarme. C’est ici qu’intervient le Défenseur des droits : il observe, décortique, sanctionne, en s’appuyant sur des critères de plus en plus affinés.
Certains cas sautent aux yeux : un CV écarté pour un prénom, une adresse, une apparence. D’autres se cachent derrière des procédures ou des logiciels de recrutement, créant des inégalités bien plus discrètes mais tout aussi réelles. Les outils numériques, mal paramétrés, peuvent reproduire des biais sans que personne ne s’en rende compte.
Le périmètre de la loi s’élargit sans cesse. Après la loi Égalité Citoyenneté, c’est la discrimination capillaire qui s’est fait une place en 2024. Les lanceurs d’alerte, eux aussi, sont désormais protégés. L’objectif demeure le même : imposer l’égalité de traitement, jusque dans les réflexes ancrés des entreprises et des professions.
Quels sont les critères de discrimination reconnus par la loi ?
La loi française a clairement posé le cadre : vingt-cinq critères, détaillés dans le Code du travail, le Code pénal et les textes récents, pour couvrir toutes les formes d’inégalités. Ce dispositif n’a cessé de se renforcer, pour coller à la réalité des pratiques et des situations.
L’article L1132-1 du Code du travail reste la pierre angulaire : aucune décision ne doit reposer sur un critère interdit. À mesure que la société évolue, la liste s’allonge. Exemple frappant : la discrimination capillaire, intégrée en 2024, qui reconnaît enfin l’impact du cheveu sur l’accès à l’emploi ou la progression de carrière.
Voici la liste officielle des critères de discrimination actuellement prohibés par la législation :
- Âge, sexe, origine, grossesse, situation familiale, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence
- État de santé, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre
- Opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, mandat électif, perte d’autonomie, domiciliation bancaire, situation économique
- Convictions religieuses ou philosophiques, capacité à s’exprimer dans une autre langue, appartenance ou non à une ethnie, une nation ou une prétendue race, qualité de lanceur d’alerte ou lien avec un lanceur d’alerte
La loi Égalité Citoyenneté a imposé des obligations renforcées, notamment la formation régulière des équipes à la non-discrimination. Sur le terrain, la frontière entre sélection légitime et exclusion illégale reste fine, particulièrement lors du recrutement ou des mobilités internes. La vigilance, ici, n’est pas un luxe : c’est une nécessité.
Comment repérer une situation de discrimination au quotidien ?
La discrimination s’infiltre dans la vie professionnelle souvent sans bruit. Elle ne se résume pas à une scène spectaculaire ou à un refus brutal. Elle s’exprime dans mille détails : une embauche refusée pour une adresse jugée « mauvaise », une promotion systématiquement bloquée après un congé maternité, un commentaire désobligeant sur la coiffure d’un salarié. Le Défenseur des droits en fait le constat : l’inégalité de traitement peut s’installer durablement dans les rouages du quotidien, à l’abri des regards.
Pour vous repérer, il faut identifier les situations où une décision, une sanction ou une exclusion vise une personne sur la base d’un critère interdit par la loi : âge, santé, handicap, sexe, origine, orientation sexuelle, identité de genre, apparence, action syndicale, appartenance réelle ou supposée à un groupe. La discrimination directe frappe d’emblée ; la discrimination indirecte, elle, se glisse dans des règles neutres en apparence mais qui écartent, au final, toujours les mêmes.
Quelques situations concrètes doivent vous alerter :
- Écartement d’une candidature sans justification objective
- Différences de salaire sans rapport avec la performance ou l’ancienneté
- Accès à la formation ou à la promotion refusé à certaines catégories de salariés
- Répartition inégale des tâches pénibles ou des postes exposés
Pour agir, il faut croiser les indices : analyse des écarts statistiques entre salariés, recueil de témoignages, examen minutieux des décisions RH. La vigilance commence avec la rédaction des offres d’emploi et se poursuit au quotidien, dans la gestion des plannings ou des évaluations. Le Code du travail et le Code pénal ne laissent aucune place à l’ambiguïté : une discrimination avérée, c’est jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.
Vos droits et les recours possibles face à la discrimination
Si la discrimination frappe, la loi offre des outils concrets. Le Code du travail interdit explicitement toute inégalité de traitement basée sur un critère prohibé. Le Code pénal va plus loin, avec des sanctions qui ne laissent pas place au doute.
Le Défenseur des droits occupe une place centrale dans la riposte. Vous pouvez le saisir gratuitement, en cas de soupçon ou pour exposer une situation douteuse. Cet organisme indépendant mène l’enquête, propose la médiation ou transmet le dossier à la justice si nécessaire. Selon le contexte, les représentants du personnel, les syndicats ou des associations spécialisées peuvent aussi intervenir pour vous accompagner.
Voici les principaux recours à envisager en cas de discrimination avérée :
- Le conseil de prud’hommes tranche la grande majorité des litiges liés à une discrimination dans l’entreprise.
- L’action de groupe, rendue possible depuis 2016, ouvre la voie à une procédure collective pour dénoncer et faire cesser des pratiques discriminatoires généralisées.
Le salarié n’est pas seul pour monter un dossier. Un avocat, un syndicat ou une association peuvent l’accompagner à chaque étape. Le droit du travail prévoit une charge de la preuve allégée : il suffit de présenter des éléments laissant supposer une discrimination, à l’employeur de se justifier. Quant aux lanceurs d’alerte, la loi les protège contre toute mesure de rétorsion. L’égalité n’est pas une faveur, c’est une obligation légale.
La lutte contre la discrimination ne s’arrête pas au texte de loi : elle se joue, chaque jour, dans les choix, les regards, les décisions concrètes. Ce combat, discret ou frontal, façonne la société de demain. Reste à chacun d’y prendre sa part, sans détour ni compromis.